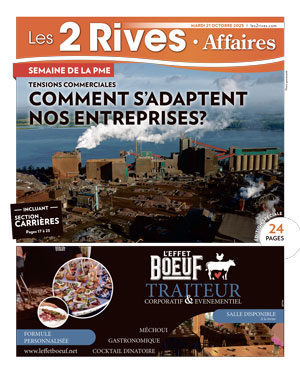Maintenant, à vol d’oiseau, planons vers le passé (1839-40). Sans aller dans la connaissance de toutes les actions de cette période trouble. Je vais décrire et peindre un portrait de la situation socio-économique et politique du Bas-Canada (le Québec d’aujourd’hui).
Au plan politique, il y avait de plus en plus de désaccords, de mésententes et de tensions. À la Chambre d’assemblée, dominée par une majorité de députés canadiens-français, s’y oppose le Conseil exécutif, composé d’anglophones, dans lequel les ministres sont choisis. Le parti patriote et son chef Louis-Joseph Papineau rédigent les 92 Résolutions. Une d’entre elles demande que les ministres soient choisis dorénavant parmi les membres de la Chambre d’assemblée. Nous nommons ce processus, la responsabilité ministérielle. Les 92 Résolutions sont acheminées en Angleterre (nous sommes une colonie). Celles-ci sont toutes rejetées par les autorités anglaises. Vives déceptions au Bas-Canada, la grogne et un amer mécontentement s’installent, en partie chez les parlementaires. D’autant plus, chez le peuple, moins nanti, les récoltes sont ravagées (blé = pain…). La détresse règne. Une épidémie de choléra s’abat sur les villages et villes. Le taux de chômage s’accroît avec l’arrivée d’immigrants anglophones. Ceux-ci prennent les « jobs » des Canadiens français.
Vous avez là les ingrédients pour l’avènement d’une révolte au Bas-Canada. Elle se transformera en la « Rébellion des patriotes » de 1837-1838. Le peuple en grande majorité, les Canadiens français endosseront le mouvement insurrectionnel. La bourgeoisie et les seigneurs seront partagés, chez les « nôtres ». Le haut clergé est pour le maintien de l’ordre et le bas clergé sera sympathique à la cause. Ils étaient près du peuple.
Donc, dans la vallée du Saint-Laurent et du Richelieu, le climat politique devient plus agité et enfiévré. Des assemblées publiques citoyennes, partisanes et patriotiques se succèdent avec entrain (Saint-Charles, Saint-Ours). Les chefs patriotes, bons tribuns, haranguent les foules. Les plus radicaux d’entre eux, dont Wolfred Nelson (député de William-Henry anciennement Sorel, dont le corps repose en paix au cimetière anglican à Sorel-Tracy), évoquent le droit et le devoir, au nom de la patrie, d’abolir le gouvernement, si celui-ci devient destructeur.
C’est ici que François Nicolas apparaît dans ce décor de fébrilité et d’effervescence révolutionnaire. Je n’ai pas trouvé une biographie exhaustive et détaillée sur François Nicolas, mais seulement quelques renseignements ici et là, dans mes recherches. Il était un modeste Canadien français.
À l’affût, curieux et renseigné, il a été instituteur, il a sûrement développé un esprit critique. Il a été indigné par les excès partiaux et arbitraires de l’establishment anglo-saxon dans son Bas-Canada, son pays.
Nicolas est né à Québec en 1797. Ayant perdu ses parents jeunes, il a été élevé par un de ses oncles, M. François Borgia, avocat de Québec. Nicolas fit un cours commercial et se mit dans le négoce, mais n’ayant pas réussi, il quitta Québec et alla se fixer à l’Acadie (près de Saint-Jean-sur-Richelieu).
Lorsque les troubles de 1837 éclatèrent, il se lança avec ardeur et prit une part active à toutes les assemblées populaires précédant l’insurrection.
Après la bataille de Saint-Denis (23 novembre 1837), la seule victoire des patriotes, il fut fait prisonnier, après un procès, il fut acquitté.
Il se rendit ensuite aux États-Unis où il prit part à l’insurrection de 1838 et se battit à Odelltown près de Lacolle. Les patriotes perdirent cette bataille. Il essaya de s’enfuir, mais ne put franchir la frontière; il retourna à Saint-Valentin, où il resta caché jusqu’au 17 janvier 1839. À la suite d’une délation, on l’arrête et on le conduisit à la prison de Montréal, c’était le 18 janvier.
Huit jours après son arrestation, il comparaissait devant la cour martiale. Nicolas fit peu d’effort pour se défendre, il se prépara à mourir. Ses ennemis, selon ce que l’on rapporte, ne purent s’empêcher d’admirer son sang-froid et sa dignité. Il monta sur l’échafaud le 15 février 1839, à l’âge de 44 ans. Certains témoins disent que ses dernières paroles furent les suivantes : « Je ne regrette qu’une chose, c’est de mourir avant d’avoir vu mon pays libre… »
François, je suis honoré que tu fasses partie de notre grande et longue descendance.
Jean Rajotte, Sorel-Tracy